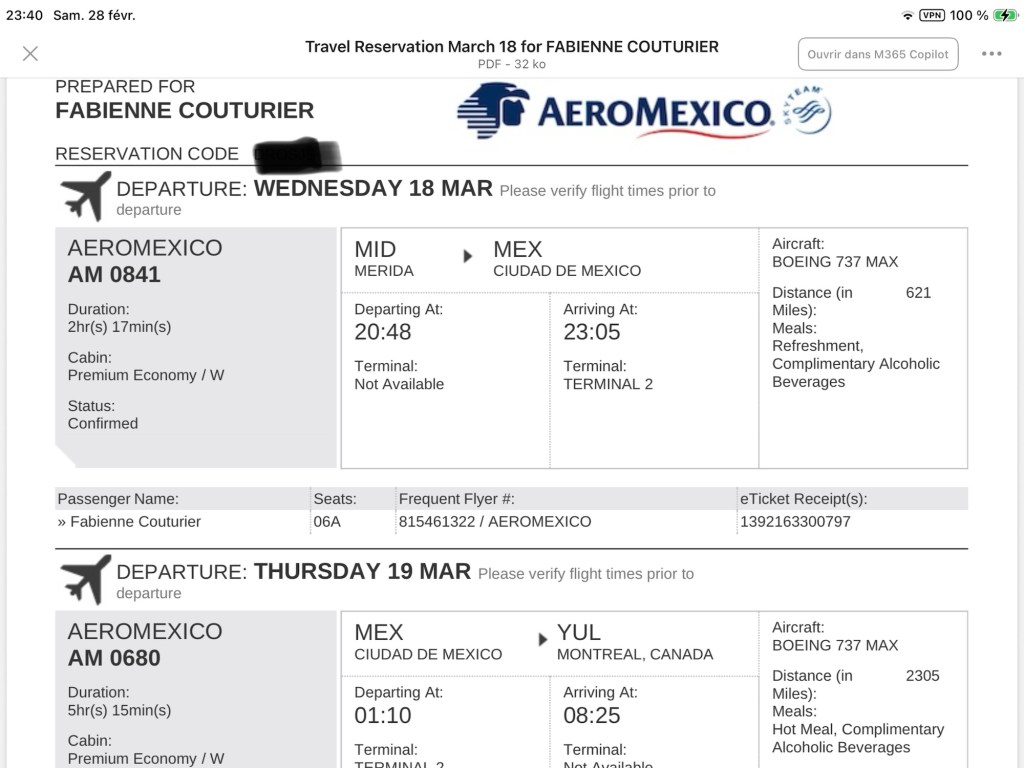Chiens
Le chien jaune universel et son compagnon noir à taches fauve règnent ici comme dans tous les pays d’Amérique latine que j’ai visités. Femelles à mamelles pendantes, mâles couillus, tous plus ou moins maigres, blessés, galeux mais le plus souvent inoffensifs, on les voit errer de-ci de-là, à la recherche de quelque chose à manger, ou forniquer à tout vent.
La question que je me pose toujours: ces chiens sont-ils des bâtards ultimes ou la source de toutes les races que l’humain a réussi à créer?

Je dois dire que ça me dégoûte un peu. J’en ai vu un hier manger le contenu d’une couche jetable abandonnée sur la plage (double, triple, quadruple eurk).
C’est sans parler du fait qu’ils défèquent partout, ce qui attire inévitablement les mouches, qui m’écoeurent au moins autant que les rats et les cafards.
J’ai bien du mal à comprendre les touristes qui se prennent d’amour pour l’une de ces bêtes et qui dépensent des fortunes pour les ramener chez eux, où les refuges débordent sans doute déjà de chiens adoptables.
En tout cas.
Ici, dans cette maison, il y a ce grand bébé bonasse de doberman appelé Duke, qui persiste à se coucher devant la porte de ma chambre comme pour me protéger de je ne sais quoi. Il est doux comme tout, il vient parfois me donner quelques coups de museau quand je lis dans le hamac, il me fait rire.

Iguanes
Un certain nombre d’iguanes (probablement quatre, selon Jaqui) squattent la maison, le jardin, le toit. On les entend se déplacer sur la tôle ondulée qui couvre la cuisine, ouverte à tous les vents; on en voit parfois un se chauffer au soleil sur le muret qui nous sépare de la cour voisine, où il s’adonne à d’étranges exercices de yoga. Malgré leur air féroce, ce sont d’inoffensifs végétariens qui ne feraient (hélas) pas de mal à une mouche.
L’autre jour, l’un a quitté la solive où il se tenait pourtant assez commodément pour s’aventurer sur le mur, à la verticale. Je ne connais rien des aptitudes des iguanes à grimper aux murs, mais celui-là a prouvé qu’il n’en avait guère et a spectaculairement chuté d’une hauteur de trois ou quatre mètres. Honteux et confus, il a choisi la première cachette à sa portée, d’où Tanya, la belle-fille de Jaqui, l’a gentiment chassé afin qu’il poursuive sa vie ailleurs. Mine de rien, ça court vite, ces petites bêtes.
Nous avons beaucoup ri.

Fourmis
Elles sont rouges et microscopiques, elles s’infiltrent partout. On ne laisse rien traîner dans la cuisine qui ne soit dans un contenant hermétique (j’avais laissé un sac de chips entamé sur l’étagère en me disant que du salé ne les intéresserait pas: erreur). On les essuie d’un coup d’éponge sur la table quand elles s’y aventurent, j’en écrase quelques-unes sur l’écran de mon iPad quand je lis au lit (oui, même là). Elles mordent cruellement quand elles se sentent prisonnières, et c’est franchement insultant quand l’une d’elles s’est infiltrée dans tes bobettes. Elles ne font pas plus d’un millimètre, mais quand elles te mordent, tu le sens.
Lézards
On les appelle iguanitos (petits iguanes), ce sont de tout petits lézards beiges extraordinairement prestes, qui ne font pas plus de quatre centimètres de longueur. On peut les observer le soir en haut des murs, où ils n’ont rien à craindre; on les surprend parfois à découvert dans un coin, d’où ils disparaissent si vite qu’on se demande si on n’a pas eu une hallucination. Je n’ai jamais réussi à en photographier un. Je lis qu’on compte 62 espèces de lézards au Mexique, choisissez votre préféré. Moi, je les aime tous.
Mouches
Je l’ai dit, je le répète, je HAIS les mouches. Elles me dégoûtent, elles m’écoeurent, elles me révulsent. D’autant plus que j’ai lu qu’il y a en ce moment dans la région une épidémie de gusano barrenador. Autrement dit, des vers de mouche à viande, qui s’attaquent principalement au bétail, mais pas que: les mouches pondent sur les muqueuses et sur toute plaie laissée à l’air libre sans soins adéquats.
EURRRRK!
Depuis le Bénin, où les mouches à marde pullulaient, je couvre toute ma nourriture et mes verres d’une serviette de papier, je refuse qu’une seule mouche touche à ma nourriture ou même au rebord de mon verre. C’est ma seule vraie phobie, et je l’assume pleinement.
Pélicans
Presque chaque jour, ils nous offrent le spectacle de leurs piqués vertigineux: vrrrrouumm SPLASH! Et un autre petit poisson dans le gargoton.
Ils volent souvent par deux, de concert, avec une coordination qui dépasse l’entendement.
On peut aussi observer des sternes, des mouettes rieuses et des frégates, juste comme ça, bien tranquilles, assises dans ce que nous appelons désormais notre salon, Michelle et moi.